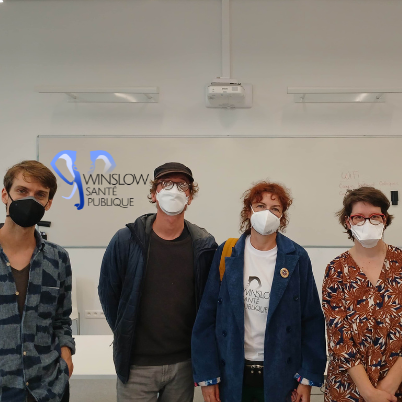COVID LONG : tout savoir
Définition et présentation du COVID long
Le COVID long est une condition médicale complexe et chronique qui survient après une infection par le virus SARS-CoV-2, qui cause la COVID-19. Il se caractérise par une série de symptômes persistants qui perdurent pendant au moins trois mois après la phase aiguë de l’infection. Ces symptômes peuvent varier et affecter plusieurs systèmes d'organes.
Les symptômes du COVID long
Les symptômes du COVID long peuvent affecter de multiples systèmes, et les patients peuvent ressentir une combinaison de ceux-ci :
- Fatigue persistante : une sensation de fatigue intense qui ne disparaît pas après le repos.
- Essoufflement : difficulté à respirer, même après un effort modéré.
- Troubles cognitifs : "brouillard cérébral", difficultés de concentration, troubles de la mémoire.
- Douleurs musculaires et articulaires : douleurs diffuses, semblables à celles observées dans la fibromyalgie.
- Symptômes cardiovasculaires : palpitations, arythmie, tachycardie, caillots sanguins, douleurs thoraciques.
- Problèmes neurologiques : vertiges, maux de tête, troubles du sommeil, troubles de la coordination, neuropathies.
- Troubles du système nerveux autonome : dysautonomie, comme l'hypotension orthostatique et une tachycardie orthostatique posturale (POTs).
- Syndromes gastro-intestinaux : nausées, diarrhées, douleurs abdominales.
Les causes et mécanismes du COVID long
Toutes les causes exactes du COVID long ne sont pas encore totalement comprises, mais plusieurs mécanismes font aujourd’hui consensus dans la communauté scientifique :
Thrombo-inflammation
La formation de microcaillots résistants à la fibrinolyse est présente chez la majorité (74 %) des patients atteints de COVID long. Ces microcaillots bloquent la circulation sanguine dans les petits vaisseaux, provoquant des dommages aux tissus, en particulier au niveau des neurones et des organes vitaux.
Ils sont responsables de symptômes tels que l'hypoxie tissulaire chronique (apport en oxygène trop faible par rapport au besoin cellulaire), des troubles cognitifs et des douleurs musculo-squelettiques.
Dysimmunité (dérèglement immunitaire et Maladies auto-immunes)
Une activation prolongée des lymphocytes T mémoires spécifiques au SARS-CoV-2, et une dysrégulation des interférons de type I/III, compromettent la capacité du corps à répondre correctement aux infections.
Une part significative (environ 20 %, selon une étude) des patients développent des auto-anticorps qui ciblent les tissus nerveux et musculaires, entraînant des symptômes persistants, notamment la fatigue et les douleurs musculaires.
Le COVID long peut être un facteur déclencheur de maladies auto-immunes, telles que le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, par mimétisme moléculaire entre la protéine Spike du virus et les antigènes humains.
Ces maladies peuvent exacerber les symptômes du COVID long et compliquer le diagnostic.
Persistance virale
La persistance virale désigne la capacité du SARS-CoV-2 à subsister dans l’organisme bien après la phase aiguë de l’infection, parfois pendant plusieurs mois, voire plus d’un an. Des études récentes ont mis en évidence la présence de matériel viral (ARN, protéines comme la Spike) dans différents tissus, notamment dans les muqueuses (intestinale, pulmonaire) et les poumons, même lorsque le virus n’est plus détectable dans les voies respiratoires supérieures ou le sang.
Cette persistance s’expliquerait par la formation de véritables réservoirs viraux, où le virus échappe à la surveillance du système immunitaire. Par exemple, il a été démontré que le SARS-CoV-2 peut persister dans les macrophages alvéolaires pulmonaires (Équipe Pasteur, Paris, N. Huot) ou dans la muqueuse intestinale, des sites immunologiquement plus permissifs. Cette situation s’accompagne d’anomalies immunitaires, notamment une diminution des cellules immunitaires spécialisées dans l’élimination des virus dans les muqueuses
De plus, on note :
Des atteintes neurologiques
- Dysautonomie : une part significative des patients présentent des troubles du système nerveux autonome, avec des symptômes comme des tachycardies inexpliquées et une hypotension orthostatique.
- Encéphalite limbique et neuro-inflammation : l'inflammation chronique des neurones, causée par la protéine Spike, entraîne des lésions hippocampiques et des troubles cognitifs.
Réactivation virale
La réactivation du virus Epstein-Barr (EBV) est observée chez la majorité (73 %, dans une étude) des patients, aggravant l'inflammation et augmentant la sévérité des symptômes.
L’effet des réinfections
Les réinfections par le SARS-CoV-2 augmentent significativement le risque de développer le COVID long, avec un risque multiplié par 170 % après deux réinfections, et par 260 % après trois réinfections.
Les réinfections augmentent également les risques de maladies auto-immunes et de dysfonctionnements neurologiques.
Les critères diagnostiques du COVID long
Le diagnostic du COVID long repose sur la persistance des symptômes au-delà de trois mois après une infection par le SARS-CoV-2, avec l'absence d'autres causes expliquant ces symptômes. Les tests et examens complémentaires (comme l'IRM cérébrale, les analyses de sang, l'évaluation cardiovasculaire) peuvent aider à évaluer les dégâts causés par la thrombo-inflammation, les atteintes neurologiques et l'activation du système immunitaire.
Les affections déclenchées par le COVID long
Le COVID long peut être un facteur déclencheur pour diverses pathologies, en particulier chez les personnes déjà vulnérables. Voici une liste non exhaustive des maladies qui peuvent se développer après une infection par le SARS-CoV-2 :
- Maladies pulmonaires interstitielles,
- Syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS),
- BPCO (Bronchopneumopathie chronique obstructive),
- Caillots sanguins et embolies pulmonaires,
- Maladies auto-immunes (lupus, polyarthrite rhumatoïde, syndrome de Sjögren, etc.),
- Encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC).
- Syndrome d'activation des mastocytes (SAMA),
- Maladies cardiovasculaires (risques d’infarctus, AVC),
- Maladie rénale chronique,
- Déficience cognitive (par exemple, due à des lésions hippocampiques),
- Fibromyalgie,
- Etc.
La prise en charge du COVID long
À ce jour, il n’existe pas de traitement curatif du COVID long. La prise en charge est personnalisée, centrée sur l’atténuation des symptômes et l’amélioration de la qualité de vie.
Elle repose sur plusieurs axes :
- Une écoute attentive du vécu du patient et une reconnaissance de ses symptômes ;
- Des traitements symptomatiques (antalgiques, soutien digestif, respiratoire, neurologique…) ;
- Une réadaptation fonctionnelle progressive, adaptée au profil du patient, en évitant tout surmenage ou reprise trop rapide de l’activité physique (risque d’aggravation chez les personnes présentant un post-exertional malaise) ;
- Un accompagnement psychologique si nécessaire ;
- Un suivi pluridisciplinaire dans des structures dédiées au COVID long.
Certaines équipes de recherche explorent actuellement des pistes thérapeutiques innovantes, mais ces traitements ne sont pas encore validés en routine.
Les dangers de la rééducation à l’effort
Les pratiques de rééducation à l’effort peuvent être dangereuses pour les patients atteints de COVID long, en particulier sans une évaluation cardiovasculaire poussée préalable. De nombreuses études ont montré que la rééducation intense peut aggraver l'état des patients, avec des symptômes comme le malaise post-effort (PEM) et l'aggravation de la fatigue chronique. Environ 50 % des patients rapportent une aggravation de leurs symptômes après des programmes de rééducation.
Il est recommandé de limiter la rééducation intensive, en raison des risques associés, notamment pour le système cardiovasculaire et les muscles.
Prévention des réinfections
Les réinfections par le SARS-CoV-2 doivent être prises très au sérieux, car elles peuvent aggraver les symptômes du COVID long et augmenter le risque de dommages organiques et complications à long terme. Il est essentiel de maintenir les mesures de protection, comme le port du masque, la ventilation des espaces, la distanciation sociale et la vaccination, pour limiter le risque de réinfections.
Les perspectives de recherche
La recherche sur le COVID long continue d’évoluer. De nombreuses études se concentrent sur la compréhension des mécanismes de la thrombo-inflammation, de la persistance virale et du dérèglement immunitaire. Des traitements ciblant ces mécanismes sont en développement, et plusieurs essais cliniques sont en cours pour mieux comprendre les causes et trouver des solutions thérapeutiques efficaces.
Conclusion
Le COVID long représente une pathologie complexe qui touche un nombre croissant de personnes. Bien que les recherches avancent, de nombreuses inconnues subsistent, notamment en ce qui concerne les causes exactes et les meilleures options de traitement. Les patients doivent être conscients des risques de réinfections, de complications auto-immunes et des dangers potentiels de certaines formes de rééducation. Un suivi médical rigoureux et personnalisé est essentiel pour la prise en charge de cette maladie.
Ce contenu a été rédigé en collaboration avec Winslow Santé Publique
Discovery of How Blood Clots Harm Brain and Body in COVID-19 Points to New Therapy, Gladstone Institutes
Phase-resolved Functional Lung MRI Reveals Distinct LungPerfusion Phenotype in Children and Adolescents withPost–COVID-19 Condition, Gesa H. Pöhler, MD • Andreas Voskrebenzev, PhD • Marc-Luca Heinze • Valentina Skeries, MD • Filip Klimeš, PhD •Julian Glandorf, MD • Jan Eckstein, MD • Nigar Babazade • Marius Wernz, BS • Alexander Pfeil, MD • Gesine Hansen, MD •Frank K. Wacker, MD • Jens Vogel-Claussen, MD • Martin Wetzke, MD* • Diane Miriam Renz, MD, Radiology 2025; 314(2):e241596 • https://doi.org/10.1148/radiol.241596
Long Covid Defined E. Wesley Ely, M.D., M.P.H., Lisa M. Brown, M.P.H., and Harvey V. Fineberg, M.D., Ph.D., for the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine Committee on Examining the Working Definition for Long Covid
Anderer S. New Research Suggests Increased Risk of Some Autoimmune Disorders After COVID-19. JAMA. 2025;333(2):111. doi:10.1001/jama.2024.24894
Reinfection with SARS-CoV-2 in the Omicron Era is Associated with Increased Risk of Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection: A RECOVER-EHR Cohort Study
View ORCID ProfileBingyu Zhang, Qiong Wu, Ravi Jhaveri, Ting Zhou, Michael J. Becich, Yuriy Bisyuk, Frank Blanceró, Elizabeth A. Chrischilles, Cynthia H. Chuang, Linday G. Cowell, Daniel Fort, Carol R. Horowitz, Susan Kim, Nathalia Ladino, David M. Liebovitz, Mei Liu, Abu S. M. Mosa, Hayden T. Schwenk, Srinivasan Suresh, Bradley W. Taylor, David A. Williams, Jeffrey S. Morris, Christopher B. Forrest, View ORCID ProfileYong Chen the RECOVER Consortium doi: https://doi.org/10.1101/2025.03.28.25324858
Rates of infection with other pathogens after a positive COVID-19 test versus a negative test in US veterans (November, 2021, to December, 2023): a retrospective cohort study, Miao Cai, PhDb,d ∙ Evan Xu, BSb,d ∙ Yan Xie, PhDa,d,e ∙ Ziyad Al-Aly, MD
Publié le 23 déc. 2020 • Mis à jour le 24 avr. 2025
La communauté Covid long
Répartition des 566 membres sur Carenity
Moyenne d'âge de nos patients
Répartition géographique de nos patients
Fiches maladies
Voir plus