Allié de la cure détox au changement de saison, le jus de bouleau purifie l'organisme en profondeur.
- Accueil
- Forums
- Forums généraux
- Bon à savoir (pour tous)
- Remèdes naturels pour mieux vivre au quotidien
Remèdes naturels pour mieux vivre au quotidien
- 14 951 vues
- 648 soutiens
- 1 606 commentaires
Tous les commentaires
Aller au dernier commentaire
Utilisateur désinscrit
@dinouille
Merci bcp
Bisous
![]()
laruns
Bon conseiller
![]()
laruns
Dernière activité le 21/08/2024 à 21:03
Inscrit en 2012
391 commentaires postés | 47 dans le groupe Bon à savoir (pour tous)
1 de ses réponses a été utile pour les membres
Récompenses
-
Bon conseiller
-
Contributeur
-
Messager
-
Engagé
-
Explorateur
-
Ami
Merci
Quand ont à une sclérose le problèmes urinaires et là certaines personnes pas tous les sepien (n'es)
Boire 1/5 d'eau ces assuraient course au WC
Donc citron me convient
Merci
Voir la signature
laruns

dinouille
Membre AmbassadeurBon conseiller
![]()
dinouille
Membre Ambassadeur
Dernière activité le 02/02/2026 à 21:23
Inscrit en 2015
132 931 commentaires postés | 106761 dans le groupe Bon à savoir (pour tous)
30 565 de ses réponses ont été utiles pour les membres
Récompenses
-
Bon conseiller
-
Contributeur
-
Messager
-
Engagé
-
Explorateur
-
Evaluateur
Adaptation du logement et prévention des chutes
La chute concerne encore trop de personnes âgées (9 000 décès par an) et reste l’accident domestique le plus fréquent chez les seniors. Mais chuter n’est pas une fatalité : l’adaptation du logement au vieillissement peut permettre de poursuivre lemaintien à domicile en toute sécurité le plus longtemps possible.
- L’adaptation du logement d’un senior passe en premier lieu par la vérification des cinq points suivants dans l’ensemble de la maison :
- des lieux de passage dégagés et une bonne accessibilité : la personne âgée doit pouvoir se déplacer dans sa maison sans risquer de buter dans des objets encombrant le sol : pots de fleurs…
- un éclairage suffisant : l’entrée de la maison et toutes les pièces du domicile doivent être bien éclairées, sans zone d’ombre ;
- des revêtements de sol appropriés : la moquette permet de ne pas glisser. On peut également installer des tapis antidérapants ;
- des portes et fenêtres faciles à ouvrir ;
- des prises électriques accessibles : elles doivent être en nombre suffisant et situées à la bonne hauteur. Les fils électriques ne doivent pas traîner au sol : il est recommandé de les fixer au mur.
L’adaptation du logement pièce par pièce
L’aménagement du logement des personnes âgées nécessite une adaptation des différentes pièces aux difficultés liées au grand âge
- :
- troubles de la vue et de la marche,
- perte de l’équilibre,
- lenteur des réflexes,
- incontinence qui pousse les aînés à se déplacer avec précipitation, etc.
Le salon est la première pièce à prendre en compte lors de l’adaptation du logement
- : la personne âgée y passe une importante partie de la journée. Exemples de mesures à prendre :
- agencer la pièce de manière à éviter les déplacements (rangements accessibles, objets usuels à portée de main) ;
- veiller au revêtement de sol : éviter ou fixer les tapis, ne pas cirer le parquet. Un projet d’adaptation du logement pourra comprendre la pose de moquette.
Plusieurs points sont à prendre en considération dans la chambre à coucher lors de l’adaptation du logement de la personne âgée
- :
- prévoir un lit adapté : il doit être à une hauteur facilitant les transferts et le matelas doit permettre une bonne stabilité ;
- s’assurer un éclairage adapté : il doit permettre d’aller aux toilettes en toute sécurité, les interrupteurs devront être accessibles depuis le lit. S’il y a une lampe de chevet, elle doit être stable et posée sur une table bien organisée (lunettes, téléphone et médicaments à portée de main).
- Il faudra également
porter une attention particulière à la cuisine lors de l’adaptation du logement.
- Il faudra donc veiller à avoir :
- un sol propre et antidérapant ;
- un bon accès aux ustensiles les plus utilisés ;
- des rangements accessibles.
Toilettes et salles de bain : pièces de tous les dangers
De nombreuses chutes se produisent dans la salle de bain, dont le sol humide peut être très glissant. Il est important d’y installer un carrelage ou un tapis antidérapant.
Le plan d’adaptation du logement doit comprendre des barres d’appui dans l’ensemble de la maison et plus particulièrement dans la salle de bain et les toilettes.
Autres mesures à mettre en œuvre pour optimiser l’adaptation des salles d’eau du logement
- :
- sécuriser la baignoire avec des barres murales et tapis antidérapants ;
- installer une douche pour éviter d’enjamber une baignoire ;
- installer des mitigeurs pour faciliter la manipulation ;
- utiliser un rehausseur de cuvette dans les toilettes ;
- rendre les toilettes accessibles depuis la chambre est l’un des aménagements importants à entreprendre lors de l’adaptation du logement.
Tous ces travaux ont un coût qui peut s’avérer élevé lorsqu’ils sont réalisés par des professionnels. Fort heureusement, il existe des aides financières pour l’aménagement du domicile. Il est possible d’en profiter dans le cadre de l’APA, notamment.
Voir la signature
dinouille

dinouille
Membre AmbassadeurBon conseiller
![]()
dinouille
Membre Ambassadeur
Dernière activité le 02/02/2026 à 21:23
Inscrit en 2015
132 931 commentaires postés | 106761 dans le groupe Bon à savoir (pour tous)
30 565 de ses réponses ont été utiles pour les membres
Récompenses
-
Bon conseiller
-
Contributeur
-
Messager
-
Engagé
-
Explorateur
-
Evaluateur
Les différents types d'aide à domicile aux personnes âgées
L’aide à domicile recouvre divers types de prestations concourant au maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. On distingue deux domaines principaux : l’aide à la vie sociale et les soins infirmiers à domicile.
L’aide à domicile, qui relève le plus souvent d’une auxiliaire de vie sociale, recouvre toutes les tâches que la personne âgée ne peut plus assumer seule :
- entretien de la maison (aide-ménagère, lessive, repassage…),
- aide à la vie quotidienne (préparation des repas, portage des repas, courses),
- actes essentiels de la vie quotidienne (toilette),
- prestations d’ordre administratif (démarches à la poste ou à la banque).
En outre, l’aide aux personnes âgées à domicile revêt également une dimension relationnelle. Grâce à la présence de l’aide-ménagère ou de l’auxiliaire de vie, la personne âgée conserve un lien social déterminant. Au-delà des tâches elles-mêmes, cette aide à domicile offre une compagnie. Elle peut faire la lecture, parler à la personne âgée, ou simplement être à l’écoute.
La téléassistance : efficace, mais impersonnelle
Cet aspect social disparaît lorsqu’on a recours à une autre forme d’aide à domicile, qui n’implique plus le facteur humain, mais la technologie : la téléassistance (ou téléalarme).
Si l’aîné ne peut avoir en permanence une compagnie, la famille peut être inquiète lorsqu’il reste seul. Pour pallier ce problème, il existe une aide présente en continu : le dispositif de téléassistance. Ce système repère les situations suspectes, comme les malaises et les chutes, et prévient les secours. Certes utile et efficace, il ne peut remplacer l’aide à domicile, car il reste coûteux et manque de contact humain.
Un autre service utile pour les seniors est le dépannage à domicile. Les associations d’aide à domicile proposent les services d’un réparateur qui peut effectuer des petits travaux chez la personne âgée, tels que la pose d’une tringle à rideaux ou le remplacement d’une prise électrique défectueuse.
Les soins infirmiers pour éviter les déplacements
L’aide à domicile peut être complétée par l’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD ou SSAD). Des infirmiers et aides-soignants viennent au domicile de la personne âgée et assurent des soins infirmiers et d’hygiène générale :
- prévention des escarres,
- surveillance des paramètres d’absorption et d’élimination,
- injections, pansements, lavage vésical,
- préparation et distribution des médicaments.
S’inscrivent également dans le cadre des SSIAD les prestations paramédicales de pédicures podologues, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes et de psychologues si besoin.
Pour être prise en charge par la Sécurité sociale, cette forme d’aide à domicile doit être prescrite par un médecin. Les soins paramédicaux sont payés à l’acte.
Le financement de l’aide à domicile
Les prestations d’aide à domicile sont proposées par des associations – comme l’UNA (ex UNASSAD) – ou des services privés à but lucratif. Il est également possible d’employer une personne indépendante. Les prix varient en fonction :
- du type de service d’aide à domicile (SAD) : prestataire ou mandataire, emploi direct,
- de son statut : privé ou associatif,
- de la zone géographique.
La principale aide financière octroyée aux seniors pour financer l’aide à domicile est l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), accordée à l’ensemble des personnes âgées de plus de 60 ans dépendantes (GIR 1-4), sans condition de ressources. L’APA permet également de rémunérer les enfants qui viennent en aide à leur proche à domicile. Dans ce cas, il peut être utile de suivre une formation pour les aidants, donnant des informations sur la façon d’octroyer une aide de qualité.
Les personnes n’ayant pas droit à l’APA (GIR 5-6), mais dont l’état de santé justifie l’intervention d’une aide à domicile, peuvent bénéficier de l’aide sociale. L’aide-ménagère pour la personne âgée est soumise à condition de ressources. Elle est versée soit par le département, soit par la caisse de retraite (en fonction des revenus de la personne âgée qui demande un financement de son aide à domicile).
Voir la signature
dinouille

dinouille
Membre AmbassadeurBon conseiller
![]()
dinouille
Membre Ambassadeur
Dernière activité le 02/02/2026 à 21:23
Inscrit en 2015
132 931 commentaires postés | 106761 dans le groupe Bon à savoir (pour tous)
30 565 de ses réponses ont été utiles pour les membres
Récompenses
-
Bon conseiller
-
Contributeur
-
Messager
-
Engagé
-
Explorateur
-
Evaluateur
Les conditions du maintien à domicile d’un aîné dépendant
La majorité des personnes âgées (90 %) choisissent le maintien à domicile. Mais lorsque la dépendance, physique ou mentale, s’installe, il devient très difficile pour un aîné de vivre seul chez lui.
Pour pouvoir rester chez soi dans de bonnes conditions, plusieurs critères doivent être réunis. Ils concernent la santé, l’environnement familial, l’adaptation de l’habitat et le niveau de ressources.
Maintien à domicile et état de santé
La dégradation de l’état de santé entraîne une incapacité totale ou partielle. Elle peut rendre le maintien à domicile dangereux, en l’absence de prise en charge adaptée. Il est donc important de s’assurer que les soins et services médicaux peuvent être assurés au domicile.
Du reste, si les troubles physiques ne sont pas toujours un obstacle au maintien à domicile, l’altération des facultés mentales est en revanche plus difficile à prendre en charge.
Maintien à domicile et disponibilité de la famille
La famille constitue la clé du maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Les proches doivent être en mesure d’aider leur parent dépendant et de venir lui rendre des visites régulières pour prévenir la solitude. Il faut parfois également trouver d’autres solutions pour rassurer l’aîné en situation de dépendance, par exemple s’abonner à un service de téléassistance, permettant une intervention rapide en cas d’urgence
Pour favoriser le maintien à domicile, des professionnels de l’aide à domicile peuvent assister les aidants familiaux, sans pour autant s’y substituer.
L'adaptation du logement pour un maintien à domicile sécurisé
L’aménagement du logement est l’une des conditions sine qua non du maintien à domicile des personnes âgées dépendantes.
L’adaptation de la maison aux besoins de la personne dépendante doit permettre d’assurer sa sécurité dans son environnement immédiat :
- remplacement d’une baignoire par une douche,
- élargissement des portes pour laisser passer un fauteuil roulant,
- pose de barres de sécurité…
Le coût du maintien à domicile des personnes âgées
Le maintien à domicile n’est possible que si les ressources de la personne âgée et sa famille permettent de financer :
- une aide professionnelle rémunérée,
- l’adaptation du logement,
- la prise en charge médicale.
Quand renoncer au maintien à domicile d’une personne âgée ?
Lorsque leur état de santé se dégrade, la prise en charge des personnes âgées peut devenir un véritable problème pour leur entourage. Le choix est alors difficile pour les proches confrontés à la dépendance d’un parent âgé : il faut choisir entre le maintien à domicile ou l’entrée en maison de retraite.
Le maintien à domicile des personnes âgées en situation de perte d’autonomie n’est possible que si un certain nombre de conditions sont remplies en matière d’environnement familial, de ressources et d’habitat.
Si ce n’est pas le cas, le maintien à domicile forcé risque de déboucher sur des situations de crises. C’est alors dans l’urgence que le placement en maison de retraite devra être décidé. Une situation inconfortable à vivre qu’il vaut mieux éviter.
En outre, le maintien à domicile ne résout pas le problème de la solitude. C’est en effet le sentiment de solitude qui reste l’écueil numéro un de l’option du maintien à domicile.
De plus, malgré les aides, notamment l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), il peut arriver que le maintien à domicile se révèle plus onéreux que la prise en charge globale de la personne par un établissement d’hébergement.
Il faut alors mettre en balance le niveau de sécurité, la prise en charge médicale et psychologique, le bien-être et le coût du maintien à domicile avec les avantages du placement en maison de retraite :
- vie collective prévenant l’isolement,
- cadre protégé,
- présence médicale continue,
- prise en charge de tous les besoins de l’aîné.
Voir la signature
dinouille

dinouille
Membre AmbassadeurBon conseiller
![]()
dinouille
Membre Ambassadeur
Dernière activité le 02/02/2026 à 21:23
Inscrit en 2015
132 931 commentaires postés | 106761 dans le groupe Bon à savoir (pour tous)
30 565 de ses réponses ont été utiles pour les membres
Récompenses
-
Bon conseiller
-
Contributeur
-
Messager
-
Engagé
-
Explorateur
-
Evaluateur
Evaluer le degré de dépendance avec la grille AGGIR
La grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie Groupe Iso Ressources) permet d’évaluer le degré de dépendance des personnes âgées. Elle détermine, au travers d’une série de questions, leur appartenance à l’un des 6 groupes GIR (‘Groupes Iso-Ressources’) de la nomenclature.
La grille AGGIR a été élaborée par des médecins de la Sécurité sociale, de la Société française de Gérontologie et par des informaticiens. Elle s’est imposée comme l’outil de référence national et est notamment utilisée dans le cadre de l’attribution de
l’APA (allocation personnalisée d’autonomie).
L’évaluation du GIR permet de décider des solutions à mettre en place pour pallier le manque d’autonomie : aides familiales, services d’aide professionnelle ou entrée en maison de retraite. Le calcul du montant de l’APA dépend du niveau dans la grille AGGIR.
La grille AGGIR évalue les fonctions mentales et capacités corporelles dans la vie courante. Elle permet de vérifier si la personne âgée peut réaliser seule correctement la plupart des activités du quotidien ou si elle a besoin d’une aide ponctuelle ou continue
AGGIR, une grille à six niveaux
Six GIR figurent dans la grille AGGIR : ils définissent le degré d’autonomie des personnes comme explicité ci-après.
GIR 1
Ce degré du modèle AGGIR regroupe les personnes immobilisées au lit ou au fauteuil et dont les facultés physiques et psychiques sont totalement altérées. Elles ont besoin continuellement de l’aide ou de la présence d’intervenants.
GIR 2
Deux types de personnes correspondent à ce degré du modèle AGGIR :
- personnes immobilisées au lit ou au fauteuil et dont les facultés psychiques sont partiellement altérées, mais qui ont besoin d’aide pour la majorité des actes de la vie quotidienne, ainsi qu’une surveillance constante,
- personnes dont les facultés psychiques sont altérées, mais qui sont toujours capables de se déplacer et ont donc besoin d’une surveillance constante.
GIR 3
Dans ce groupe du modèle AGGIR, on trouve les personnes qui ont une relativement bonne autonomie mentale, mais seulement une partie de leur autonomie motrice. Elles ont besoin plusieurs fois par jour d’une assistance pour leurs soins corporels.
GIR 4
Ce degré du modèle AGGIR regroupe :
- les personnes incapables d’effectuer seules leurs transferts, mais capables de se déplacer dans leur domicile, une fois levées. Elles ont besoin d’une aide ou d’une stimulation pour la toilette et l’habillage, mais s’alimentent seules en général.
- les personnes sans problèmes moteurs, mais qui ont besoin d’une assistance pour les soins corporels et les repas.
GIR 5
Ce degré de la grille AGGIR comprend les personnes qui se déplacent chez elles, s’alimentent et s’habillent seules, mais qui ont besoin d’une assistance occasionnelle pour la toilette et les tâches domestiques.
GIR 6
Le dernier niveau de la grille AGGIR comprend les personnes autonomes.
Seuls les quatre premiers degrés de la grille AGGIR permettent de bénéficier de l’APA.
Critères d'évaluation de la grille AGGIR
L’évaluation de la grille AGGIR se fait sur la base de dix critères relatifs à la perte d’autonomie physique et psychique. Seules ces dix variables du modèle AGGIR, dites discriminantes, sont utilisées pour déterminer le GIR :
- Cohérence : converser ou se comporter de façon sensée ;
- Orientation : se repérer dans le temps et l’espace ;
- Toilette : se laver seul ;
- Habillage : s’habiller, se déshabiller, se présenter ;
- Alimentation : manger des aliments préparés ;
- Élimination : assumer l’hygiène urinaire et fécale ;
- Transferts : se lever, se coucher, s’asseoir ;
- Déplacements à l’intérieur : mobilité spontanée, y compris avec un appareillage ;
- Déplacements à l’extérieur : se déplacer à partir de la porte d’entrée sans moyen de transport ;
- Communication à distance : utiliser les moyens de communication, téléphone, sonnette, alarme.
Sept autres variables sont également prises en compte dans l’évaluation à l’aide du modèle AGGIR. Elles n’interviennent toutefois pas dans le calcul du GIR. Ces variables du modèle AGGIR sont dites illustratives et concernent les activités corporelles, domestiques et sociales:
- Gestion : gérer ses propres affaires, son budget, ses biens ;
- Cuisine : préparer ses repas et les servir ;
- Ménage : effectuer l’ensemble des travaux ménagers ;
- Transport : prendre ou commander un moyen de transport ;
- Achats : acquisition directe ou par correspondance ;
- Suivi du traitement : se conformer à l’ordonnance du médecin ;
- Activités de temps libre : pratiquer des activités sportives, culturelles, sociales, de loisirs ou de passe-t
Voir la signature
dinouille

dinouille
Membre AmbassadeurBon conseiller
![]()
dinouille
Membre Ambassadeur
Dernière activité le 02/02/2026 à 21:23
Inscrit en 2015
132 931 commentaires postés | 106761 dans le groupe Bon à savoir (pour tous)
30 565 de ses réponses ont été utiles pour les membres
Récompenses
-
Bon conseiller
-
Contributeur
-
Messager
-
Engagé
-
Explorateur
-
Evaluateur
Comment obtenir des aides financières pour l’aménagement du domicile ?
Vous ne savez pas où vous adresser pour demander les aides financières qui vous permettront de réaliser les travaux nécessaires à l’amélioration ou à l’aménagement du logement de votre proche âgé ? Vous n’êtes pas seuls ! Diverses associations ont pour but d’aider les personnes cherchant à améliorer ou adapter leur domicile.
Par exemple, le PACT ARIM (www.pact-arim.org) propose des conseils techniques et aide la personne à procéder aux démarches permettant d’élaborer un plan de financement en fonction de sa situation personnelle. L’association s’occupe de :
- l’évaluation au domicile de la personne par un ergothérapeute,
- la rédaction de préconisations,
- l’envoi de techniciens qui vérifient si les changements sont réalisables,
- la préparation de croquis,
- la demande de devis,
- la demande d’aides financières pour l’aménagement du domicile.
D’autres organismes proposent une aide similaire :
- l’Agence nationale ou départementale pour l’information sur le logement (ANIL ou ADIL),
- la Fédération nationale d’habitat et développement (H&D),
- l’organisme Soliha.
Les aides financières de l'ANAH pour l’aménagement du domicile
Les personnes propriétaires de leur logement et qui y résident (propriétaires occupants) ou qui le louent (propriétaires bailleurs) peuvent bénéficier d’aides financières de l’ANAH pour les travaux d’aménagement du logement à la perte d’autonomie.
La subvention est de 35 ou 50 % du montant des travaux, selon les ressources (respectivement modestes ou très modestes). Le plafond des dépenses liées aux travaux subventionnables est de 20 000 euros HT.
Pour bénéficier de ces aides financières pour l’aménagement du domicile, la personne ou le ménage doit avoir des ressources inférieures à certains plafonds (trois catégories de plafonds définissent des niveaux d’aide différents), mis à jour le 1er janvier de chaque année. Ces plafonds peuvent être consultés sur le site de l’ANAH : www.anah.fr.
À noter : les propriétaires aux faibles ressources peuvent également bénéficier d’une subvention finançant des travaux de rénovation thermique, appelée « prime Habiter mieux ». Ces travaux doivent pouvoir réduire d’au moins 25 % la facture énergétique du ménage. L’aide financière de l’ANAH pour l’aménagement thermique du domicile est de 10 % du montant total des travaux HT.
Les aides financières de l'assurance retraite pour l’aménagement du domicile
La CNAV propose une aide visant à favoriser le bien-être des personnes âgées vivant à domicile. Cette aide, le Plan d’actions personnalisé (PAP) comprend plusieurs prestations liées au maintien à domicile :
- installation de la téléassistance,
- aides techniques et humaines,
- aide financière pour l’aménagement du domicile.
Les bénéficiaires doivent :
- être titulaires d’une retraite du régime général à titre principal,
- être âgés d’au moins 55 ans,
- avoir besoin d’aide.
La demande d’aide financière pour l’aménagement du domicile se fait auprès de la caisse régionale, qui effectue une évaluation des conditions de vie et des besoins de la personne âgée.
L’évaluateur de la CNAV visite le domicile et fait part de ses conseils et ses préconisations pour l’aménagement du domicile, puis élabore un plan d’aide financière. Ce plan est soumis à la caisse régionale qui décide de l’aide financière pouvant être accordée pour l’aménagement du domicile en fonction des ressources du demandeur.
La CNAV propose également un kit de prévention des chutes, comprenant des équipements tels que des rehausseurs de WC, des barres d’appui, etc. Le forfait de 100 à 300 euros, en fonction du kit, comprend les équipements et leur pose.
L’ensemble des prestations prises en charge dans le cadre du PAP est plafonné par à 3 000 euros/an.
À noter : la MSA (Mutualité sociale agricole) et le RSI (Régime social des indépendants) accordent également des aides financières pour l’aménagement du domicile. Pour connaître les conditions d’attribution de ces subventions, il convient de s’adresse à leurs branches départementales.
Les déductions d'impôt
Les travaux d’adaptation du logement donnent droit à un crédit d’impôt de 25 % de l’investissement (équipement + pose). Le plafond de ce crédit est de 5 000 euros (10 000 euros pour un couple) sur cinq ans.
Les travaux concernés sont :
- les sanitaires : éviers, lavabos à hauteur réglable, baignoire à porte…
- les équipements de sécurité et d’accessibilité : revêtement de sol antidérapant, système de commande à distance des installations électriques…
Voir la signature
dinouille

Utilisateur désinscrit
jus de bouleau
Pour réaliser du jus de bouleau, les feuilles de bouleau sont sélectionnées et récoltées une fois par an. Par exemple, la marque Weleda les cultive en République Tchèque dans la région de Bohème. Le domaine est à l’abri de l’agriculture intensive ce qui permet d’obtenir une récolte naturelle sans produit chimique. La qualité des feuilles de bouleau est très importante pour la confection du jus. L’élément qui permet d’en juger est notamment leur odeur enivrante.
Avant d’être envoyées en décoction, les feuilles sont traitées une par une en laboratoire. A ce stade, si une trace de pesticide est détectée, c’est l’ensemble du lot qui vient à être supprimé. Une fois la décoction terminée, le jus de bouleau a son aspect vert pâle et aqueux définitif et est prêt à être dégusté.
Le jus de bouleau est diurétique et dépuratif
Cette préparation aux extraits de feuilles de bouleau agit sur les fonctions physiologiques. Ses agents diurétiques et dépuratifs permettent à l’organisme d’éliminer toxines et poisons, un moyen à long terme d'être un excellent détoxifiant. La boisson intervient aussi fréquemment lors de régimes minceurs grâce à ses fonctions "nettoyantes".
En plus de purifier le corps, le jus de bouleau est recommandé pour les personnes souffrant d’arthrite ou d’arthrose, de calculs rénaux et d’eczéma.
Commencer une cure au début de chaque saison est essentiel pour assainir le corps et retrouver un joli teint !
Cinq bonnes raisons d’adopter le jus de bouleau
- Il permet de lutter activement contre la rétention d’eau,
- En cure detox, il purifie le corps avant le début de chaque saison et/ou changement de température,
- Il soulage les douleurs articulaires (arthrite, arthrose notamment),
- C’est un produit bio 100% naturel,
- Il s'utilise en complément d’un régime alimentaire adapté.
La cure de jus de bouleau
Chaque début de saison marque un changement dans le rythme de l’organisme. L’hiver, le corps est plus fragile, et au printemps il a besoin de retrouver équilibre et vitalité. Afin qu’il adopte un mécanisme naturel tout au long de l’année, faites des petites cures régulières de trois semaines de jus de bouleau.
Prendre 2 à 3 cuillères de jus de bouleau par jour pendant trois semaines minimum. Vous pouvez le boire pur, dilué dans une infusion ou dans une bouteille d’eau pour en consommer toute la journée.

Utilisateur désinscrit
@dinouille
Merci bcp pr ton aide
Bisous

dinouille
Membre AmbassadeurBon conseiller
![]()
dinouille
Membre Ambassadeur
Dernière activité le 02/02/2026 à 21:23
Inscrit en 2015
132 931 commentaires postés | 106761 dans le groupe Bon à savoir (pour tous)
30 565 de ses réponses ont été utiles pour les membres
Récompenses
-
Bon conseiller
-
Contributeur
-
Messager
-
Engagé
-
Explorateur
-
Evaluateur
@angelina Pas de soucis,les ami(e)s les vrai(e)s sont là pour ça.Bisous.
Voir la signature
dinouille
Articles à découvrir...

24/01/2026 | Conseils
Compléments vitaminiques sans suivi médical : pourquoi “plus” n’est pas toujours mieux
S'abonner
Vous souhaitez être alerté des nouveaux commentaires
Votre abonnement a bien été pris en compte

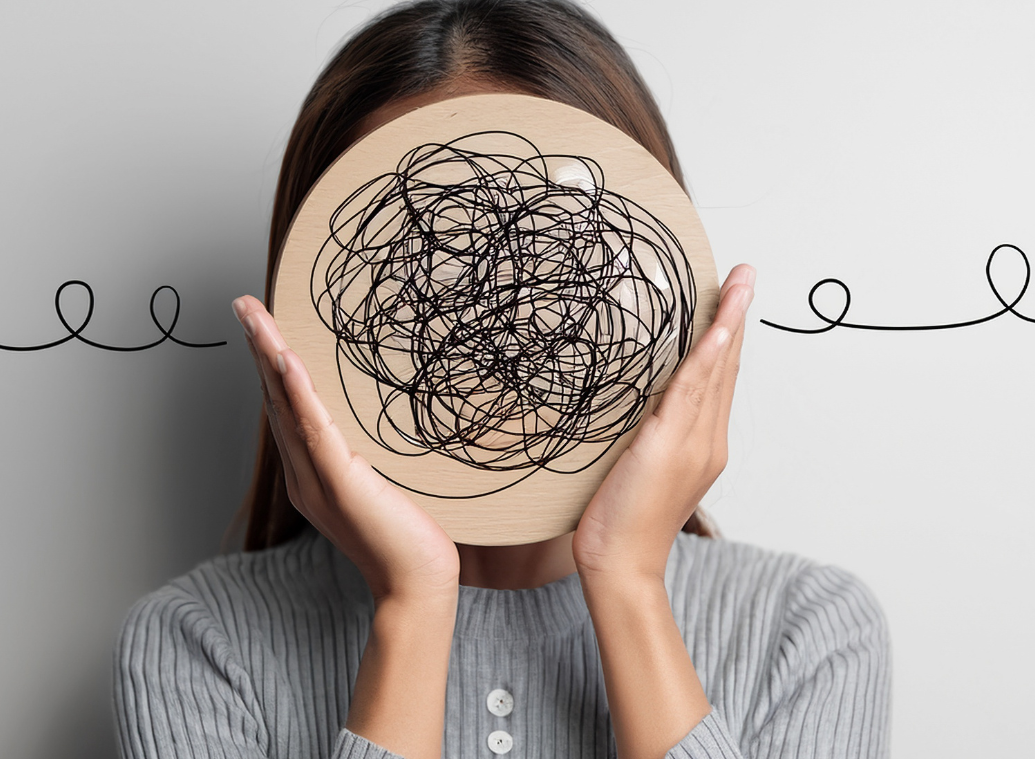






Utilisateur désinscrit
Tisane antiarthrose :préparation à faire par un herboriste, 40gr de prêle (plante entières) 30 gr de cassis (feuilles) 30 gr de frêne (feuilles) et 30grs d'orties (sommités fleuries) 1 c à s du mélange par tasse. Mettez de l'eau frémissante et laissez infuser pendant 15 minutes. Buvez 2 tasses/jours pendant 25 jours. Cette cure est à faire en automne et au printemps, voir plus souvent en fonction du degré d'arthrose. En traitement de fond, prenez cette tisane tous les jours pendant 3 semaines puis cessez 1 semaine puis recommencez, et ainsi de suite. CA VAUT LA PEINE D ESSAYER